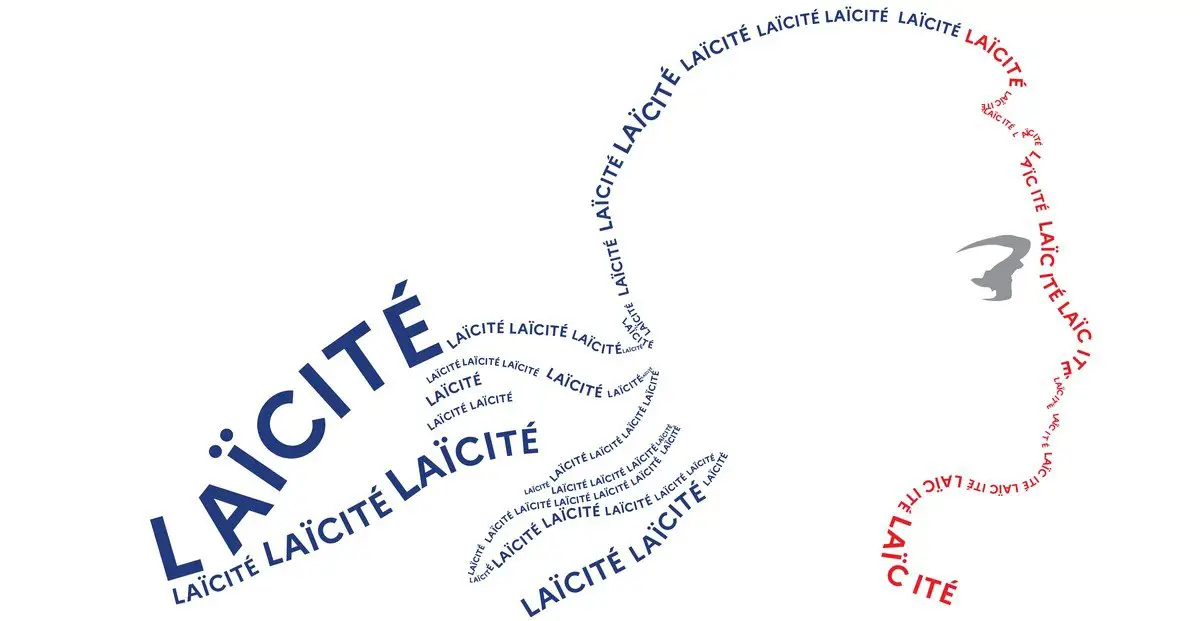Dire que la proposition de loi « visant à assurer le respect du principe de laïcité dans le sport » suscite des débats animés est un euphémisme.
Par Alban BENNACER, Avocat au Barreau de Paris
Dans sa rédaction issue de son adoption par le Sénat en première lecture le 18 février 2025, elle prévoit notamment que « lors des compétitions départementales, régionales et nationales organisées par les fédérations sportives délégataires, leurs organes déconcentrés, leurs ligues professionnelles et leurs associations affiliées, le port de tout signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance politique ou religieuse est interdit aux acteurs de ces compétitions ».
Il s’agit donc de préserver la neutralité religieuse et politique de certaines compétitions sportives et non d’« interdire le voile dans le sport » comme on peut le lire ici ou là. L’interdiction, si elle était promulguée, concernerait toute religion, quelle qu’elle soit. Laissons de côté la question de la neutralité politique : si l’organisation du sport est politique, sa pratique ne doit, quant à elle, pas devenir un théâtre de propagande idéologique. Tel est d’ailleurs l’esprit de l’article 50-2 de la Charte olympique. S’agissant en revanche de la neutralité religieuse, certains adversaires de la proposition de loi soutiennent notamment que cette dernière violerait l’article 9 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme (« CESDH ») qui garantit la liberté de pensée, de conscience et de religion.
Pourtant, si le paragraphe 1 de ce texte protège cette liberté, son paragraphe 2 permet néanmoins d’apporter des restrictions à la liberté de manifester sa religion ou ses convictions, restrictions qui doivent être nécessaires et proportionnées pour être admises par la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH). Or de nombreuses décisions de la Cour montrent qu’elle laisse une large marge de manœuvre aux États membres en la matière et qu’elle autorise de telles restrictions, notamment au nom :
• de la préservation des conditions du « vivre ensemble » (CEDH, gr. ch., 1er juillet 2014, S.A.S. c/ France, n° 43835/11 et CEDH, 11 juillet 2017, Dakir c/ Belgique, n° 4619/12) ;
• de la sauvegarde du principe constitutionnel de laïcité (CEDH, 30 juin 2009, Tuba Aktas c/ France, n° 43563/08) ;
• du respect des règles internes des établissements scolaires qui s’appliquent à tous les élèves sans distinctions en cours d’éducation physique (CEDH, 4 déc. 2008, Dogru c/ France, n° 27058/05) ;
• de la conciliation des intérêts des divers groupes coexistant au sein d’une même population et du respect des convictions de chacun (CEDH, gr. ch., 10 nov. 2005, Leyla Sahin c/ Turquie, n° 44774/98).
Ces exemples montrent que, comme le rappelle régulièrement la Cour, « l’article 9 ne garantit pas toujours le droit de se comporter d’une manière dictée par une conviction religieuse » et invitent donc à la prudence dans l’anticipation de ce que pourrait être la position de la CEDH quant à la conventionnalité de la loi, si elle était adoptée.
Il paraît hasardeux d’affirmer, comme certains, qu’elle serait nécessairement contraire à la liberté de religion telle qu’elle est garantie par l’article 9 de la CESDH.